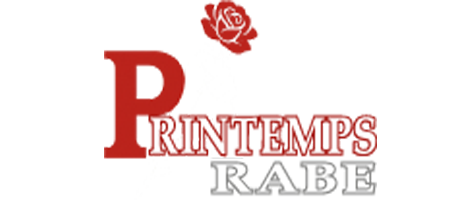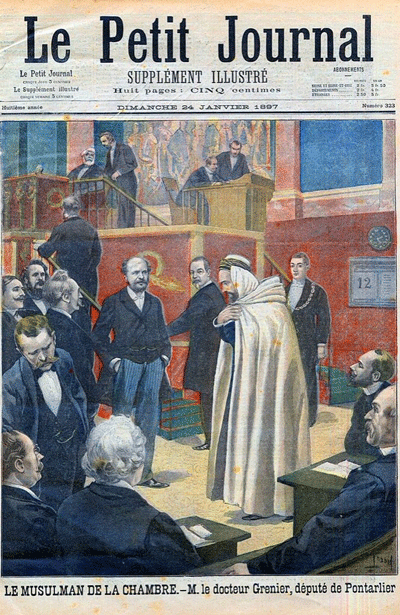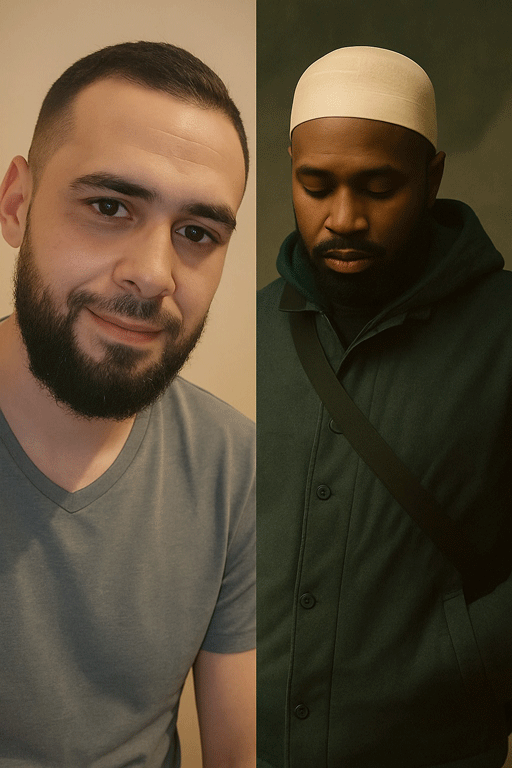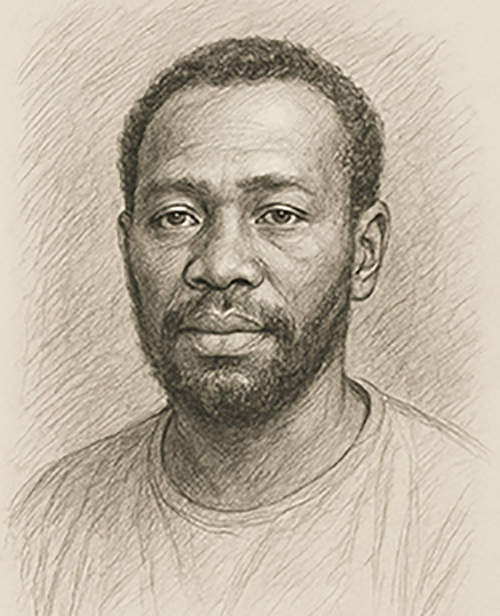Cour constitutionnelle en Tunisie : L’ARP et le renversement paradoxal de la loi fondamentale
Alors que la question de la reconnaissance de l’État palestinien refait surface dans les discours diplomatiques occidentaux, et notamment en France, il est impératif de rappeler une vérité éclipsée depuis des décennies : l’existence politique et juridique de l’État palestinien est consubstantielle à celle d’Israël. Penser l’un sans l’autre, c’est méconnaître le sens même du projet de partition de 1947. Ce n’est pas une nouvelle doctrine qu’il faut annoncer, mais un oubli à réparer. La reconnaissance palestinienne n’est pas une faveur à négocier, mais une obligation de droit, un acte de justice, et une urgence morale.
Extrait du communiqué de l’ARP
« Le Bureau a pris acte du retrait de la proposition de loi organique relative à la Cour constitutionnelle : cinq des dix signatures initiales ayant soutenu le texte ont été retirées, ce qui, selon le deuxième alinéa de l’article 124 du règlement intérieur de l’ARP, rend le retrait formellement conforme aux règles internes. »
Négation constitutionnelle
En agissant ainsi, les députés ne font pas qu’ajourner un simple projet législatif : ils créent, paradoxalement, une situation où la loi organique prime sur la Constitution elle-même. La loi fondamentale de 2014 fixe l’existence et les compétences de la Cour, et seule la Constituante pouvait la modifier. Pourtant, en traitant le texte d’application comme un « luxe » contingent, on renverse la hiérarchie des normes : c’est, contre toute logique juridique, la loi d’application qui devient la norme dirimante, au détriment du pacte originel.
Le paradoxe parlementaire
Le paradoxe atteint son paroxysme lorsqu’on réalise que les mêmes élus ont porté la proposition avant de s’en désolidariser : un coup d’éclat pour la forme, puis un recul aussitôt envisagé pour la politique. Cette manœuvre postule que la mise en place d’un juge de la Constitution est une « nice to have », un luxe dispensable sous la pression des calculs d’appareil. Pourtant, sans ce juge, aucun texte — loi, décret ou arrêté — ne peut être soumis à un contrôle suprême, ce qui laisse le champ libre à l’arbitraire et affaiblit durablement le contrôle des pouvoirs : un paradoxe révélateur d’une conception instrumentale du droit.
Transformer l’essentiel en accessoire
En confondant la réforme constitutionnelle, indissociable de la construction démocratique, avec une loi organique subordonnée, l’ARP vide la première de son sens. Le dossier de la Cour constitutionnelle, censé marquer l’achèvement de la transition, est ramené à un enjeu tactique – repoussé au gré des intérêts partisans et des équilibres mouvants. Ce glissement transforme une obligation constitutionnelle, qui engage l’avenir des institutions et des libertés publiques, en simple variable d’ajustement parlementaire, mise en suspens par des signatures retirées au gré des alliances.
Conséquences et responsabilités
Ce retrait n’est pas un simple désagrément administratif : il constitue un camouflet pour la Tunisie en transition. Privé de gardien constitutionnel, le système juridique reste orphelin de tout arbitre indépendant, exposant la société à des décisions unilatérales, sans recours effectif. La responsabilité en incombe non seulement aux signataires initiaux, prompts à l’affichage constitutionnel, mais aussi à ceux qui, aujourd’hui, privilégient la préservation du statu quo d’un pouvoir centralisé, sans contre-poids.
Echo du retrait de la Cour africaine des droits de l’homme
En mars 2025, la Tunisie annonçait déjà son retrait de la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, mettant fin à la possibilité pour les individus et les ONG de saisir directement cette instance panafricaine. Ce précédent scelle désormais la doctrine des « professionnels du retrait permanent » : une frange politique qui refuse toute contrainte et se désengage systématiquement de tout garde-fou susceptible de limiter la volonté de l’exécutif.
Problématique : l’État de droit en sursis
À l’heure où le président Kais Saïed met en scène des réformes locales — décentralisant théoriquement les compétences — la question fondamentale demeure : peut-on bâtir une démocratie sans garant suprême du pacte constitutionnel ? Ce dévoiement de la loi organique interroge la nature même de notre régime : un État de droit qui renonce à ses propres vérificateurs perd sa substance. Le vrai défi n’est pas la délimitation des circonscriptions municipales, mais la pose des fondations institutionnelles, sans lesquelles la décentralisation risque de n’être qu’un leurre.
dernière vidéo
news via inbox
PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.