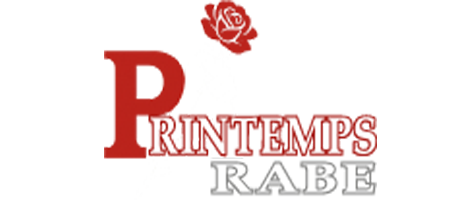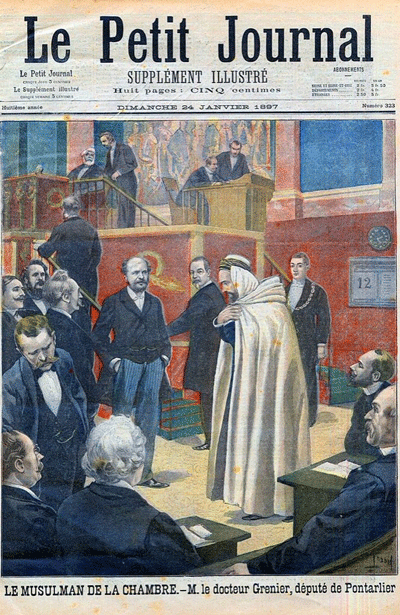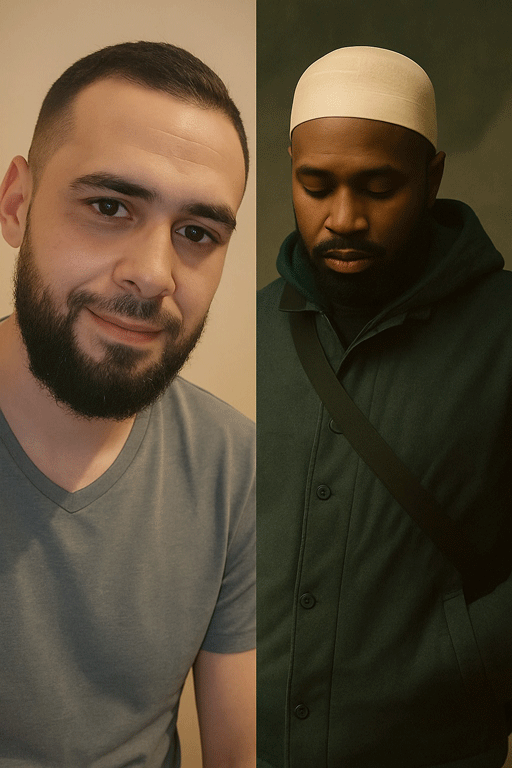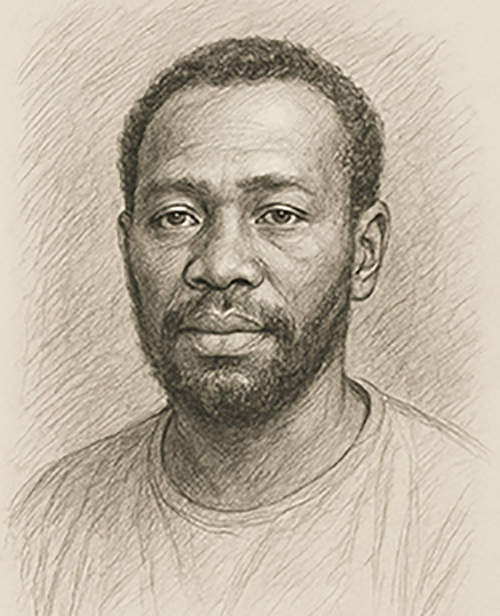La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme : Histoire d’une institution tiraillée entre idéal démocratique et instrumentalisations politiques
Fondée en 1977, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) a longtemps été un symbole de pluralisme et de résistance civile dans un contexte autoritaire. Pourtant, son histoire complexe est aussi celle d’une institution traversée par des tentatives successives de récupération politique, marquée par l’influence tour à tour des libéraux, des islamistes, des gauches radicales et des réseaux de pouvoir. Retour sur les trois grandes phases de cette organisation emblématique, entre idéal démocratique et instrumentalisation idéologique.
I. La genèse d’un contre-pouvoir libéral et pluraliste (1977–1989)
C’est sous l’égide d’une frange libérale du Néo-Destour, et avec l’œil indulgent d’un Habib Bourguiba vieillissant mais conseillé par ses ministres les plus démocrates, que naît la LTDH. Le contexte est celui d’une Tunisie autoritaire, mais consciente des tensions qui parcourent la société. Il s’agissait alors d’offrir un cadre juridique et politique aux opposants afin de désamorcer les conflits violents potentiels et de donner une vitrine « civilisée » à l’État tunisien sur la scène internationale.
Dès ses origines, la LTDH se distingue par son éclectisme idéologique. Elle rassemble des personnalités issues de différents horizons : des socialistes du Destour, des libéraux convaincus, mais aussi des islamistes modérés comme feu Sahnoun Jouhri, ou encore le philosophe Ben Aïssa Demni, intellectuel proche des milieux religieux éclairés. Ce pluralisme faisait alors de la Ligue une véritable agora démocratique, capable de poser les fondements d’une culture des droits dans une société sous contrôle autoritaire.
Pendant plus d’une décennie, la LTDH s’impose comme un arbitre moral, un pôle d’alerte contre les abus, tout en restant en équilibre précaire entre critique du pouvoir et tolérance implicite de ce dernier.
II. La période de conquête et de domestication (1989–2022)
L’accession de Zine El-Abidine Ben Ali au pouvoir le 7 novembre 1987 inaugure une nouvelle phase. Pendant quatre ans, la Tunisie connaît une embellie démocratique de façade. La LTDH, comme d'autres acteurs de la société civile, en tire un sursis d’autonomie. Mais cet interlude sera bref.
Dès 1991, la répression contre les islamistes de Ennahdha s’intensifie, et la LTDH devient un enjeu stratégique pour le régime : soit elle est domptée, soit elle est contournée. C’est dans ce contexte qu’émergent des figures ambiguës comme Chehi Ben Younes, alors relais du pouvoir dans le secteur associatif, ou encore Khemaïes Chammari et Khemaïes Ksila, figures issues d'une gauche dite "éradicatrice", prônant l’exclusion des islamistes de tout espace légal.
En 1994, cette mouvance veut transformer la LTDH en outil idéologique, vidée de son pluralisme originel. L’enjeu est clair : priver l’opposition islamiste, mais aussi d’autres dissidences, d’un outil légitime de défense. Cette tendance "domestiquée" de la Ligue va perdurer, survivant aux changements politiques, s’adaptant tantôt au jeu de la "transition démocratique" post-2011, tantôt aux rapports de force imposés par les partis de gauche ou par des franges sécuritaires de l’État.
III. La tentative actuelle de reconquête autoritaire (2022–aujourd’hui)
Depuis 2021, avec le gel du Parlement et la concentration des pouvoirs par le président Kaïs Saïed, une nouvelle phase s’ouvre : le démantèlement progressif des contre-pouvoirs. La dissolution de plusieurs institutions – l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), l’ISIE (remaniée), le Conseil supérieur de la magistrature, ou encore le blocage de la Cour constitutionnelle – participe d’un recentrage autoritaire de l’État.
Dans ce contexte, la LTDH fait face à une nouvelle forme de récupération. Une frange entristes d’orientation communiste souverainiste — notamment issue de la mouvance Watad, historiquement alliée à des réseaux sécuritaires et au pouvoir — tente de prendre le contrôle de l’organisation. Ces courants, tout en partageant avec le régime actuel une hostilité viscérale à l’islam politique, poursuivent une logique de contrôle idéologique de la société civile, sur fond de nostalgie marxiste-léniniste.
Le mode de fonctionnement de la LTDH en devient opaque et verrouillé : pas de publications régulières des échéances électorales, candidatures filtrées, cooptations internes, et un processus de renouvellement des directions proche de la succession monarchique. La Ligue semble désormais aux mains d’un club fermé, où cohabitent les deux dernières familles communistes : le PCOT de Hamma Hammami et le Watad de Zied Lakhdhar. Leurs principaux critiques ? D’autres franges de gauche, comme celle de Mongi Rahoui, jugés plus "sécuritaires" mais tout aussi hostiles aux islamistes.
Vers une refondation démocratique ?
Cette nouvelle tentative de reconquête par la gauche radicale pourrait, paradoxalement, ouvrir la voie à une refondation. En dévoilant les pratiques sectaires et l’entre-soi idéologique de la Ligue, elle remet à l’ordre du jour les principes fondateurs de 1977 : pluralisme, ouverture, indépendance vis-à-vis du pouvoir, et surtout défense universelle des droits humains, quel que soit le camp politique de la victime.
La question reste entière : la Ligue peut-elle redevenir ce qu’elle fut à sa création, un outil citoyen démocratique, ou restera-t-elle l’ombre d’elle-même, tiraillée entre factions, idéologies et fidélités croisées au pouvoir ?
dernière vidéo
news via inbox
PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.