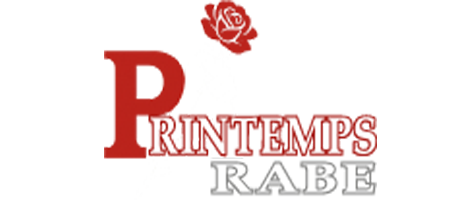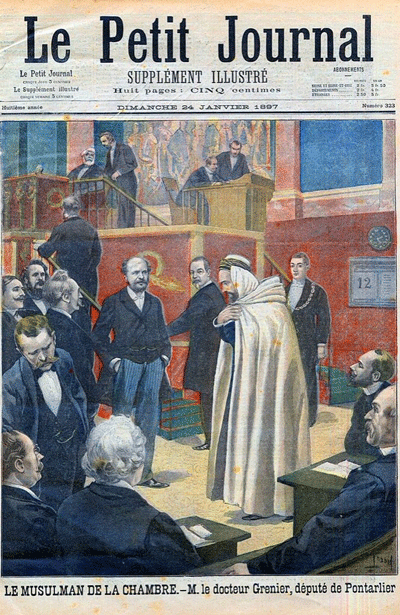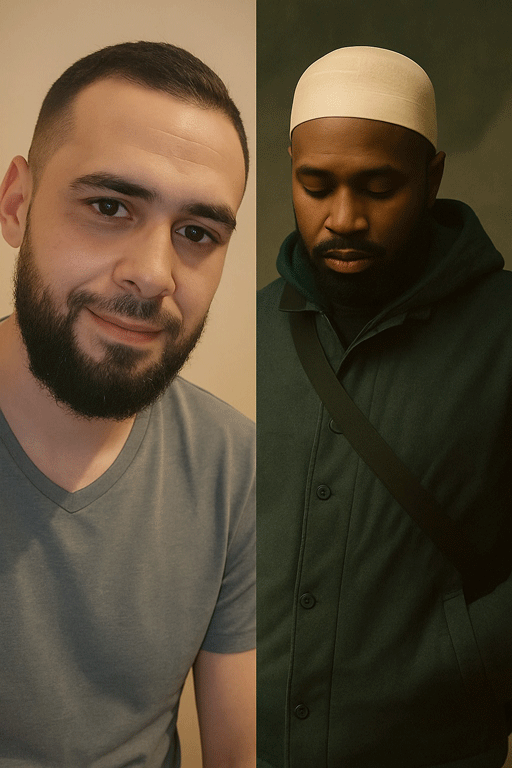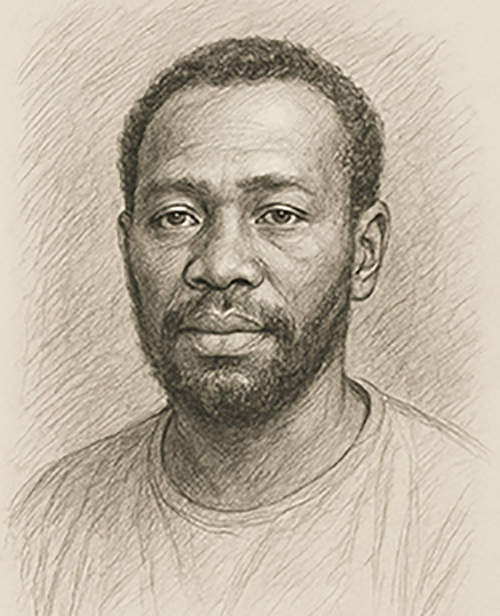Tunisie – Russie – Sahel : dans l’ombre de Djerba, la nouvelle guerre froide aux portes du Maghreb
La récente libération en Tunisie d’un groupe de ressortissants russes arrêtés avec des armes interroge. Le contexte régional est incandescent : percée russe en Libye, tensions au Sahel, pressions migratoires, intérêts énergétiques, guerre d’influence entre puissances globales et stratégies enchevêtrées entre voisins. À travers les coulisses d’un fait divers diplomatique, c’est une recomposition silencieuse mais profonde de l’équilibre géopolitique du Maghreb et du Sahel qui se joue. Enquête sur les dessous d’un dossier sensible.
Quand la géopolitique s’invite au poste de police : une libération qui dérange
Le 10 avril, dans la relative discrétion d’un communiqué sécuritaire tunisien, des ressortissants russes arrêtés sur le sol national pour possession illégale d’armes ont été libérés. Officiellement, aucune pression, aucun lien avec la visite quasi simultanée du ministre algérien des Affaires étrangères à Tunis. Mais pour quiconque suit la recomposition silencieuse des équilibres stratégiques en Afrique du Nord, la concomitance n’est pas anodine. Il ne s’agit peut-être pas de coïncidence, mais d’alignement. Et cet alignement raconte quelque chose de plus grand : le déplacement du centre de gravité des relations internationales dans la région.
La Russie, depuis une décennie, a fait de l’Afrique une scène d’expression d’un multipolarisme revendiqué, et le Maghreb, longtemps sous le parapluie occidental, n’y échappe plus. La Tunisie, pivot fragile entre Méditerranée et Sahara, entre démocratie vacillante et tentations autoritaires, entre Occident et puissances émergentes, est aujourd’hui scrutée autant que courtisée.
Libye : la pièce maîtresse russe dans le Grand Jeu africain
Depuis l’intervention de l’OTAN en 2011 et la chute de Kadhafi, la Libye est un théâtre ouvert à toutes les influences. Mais ces dernières années, la Russie y a pris une longueur d’avance. D’abord discrètement, via des sociétés de sécurité privées comme Wagner, puis plus frontalement, en tissant des liens militaires avec l’homme fort de l’Est libyen, Khalifa Haftar. En soutenant l’Armée nationale libyenne, Moscou s’est offert une profondeur stratégique en Afrique du Nord, un pied militaire sur la Méditerranée, et une position de levier sur les routes migratoires, les gisements d’hydrocarbures, et les transitions politiques du Maghreb.
Ce jeu d’influence n’est pas sans conséquences sur la Tunisie. Djerba, tout près de la frontière libyenne, a été identifiée par les États-Unis comme une plateforme logistique potentielle pour les forces russes. Le département d’État américain, relayé par La Repubblica et Courrier international, s’inquiète de vols militaires russes vers l’île, mais aussi du rôle trouble que pourrait jouer Wagner – ou ses successeurs – dans les flux migratoires qui convergent vers le littoral tunisien depuis les confins du Sahel.
Tunisie : fragilité politique, porosité sécuritaire, vulnérabilité géostratégique
La Tunisie post-révolution a toujours été un équilibre instable. Depuis 2011, les transitions politiques, parfois inspirantes, souvent chaotiques, ont laissé des institutions faibles et une sécurité intérieure perméable. Plusieurs affaires ont illustré ces failles : en 2013, l’arrestation de Fathi Dammak, accusé de préparer des assassinats politiques ; en 2019, la saisie d’un conteneur d’armes dissimulées, prétendument destiné à un homme d’affaires belge. Et aujourd’hui, la présence discrète mais croissante d’éléments russes, certains armés, dans le Sud tunisien.
Si ces cas ne sont pas nécessairement liés, ils dessinent une tendance : la Tunisie est devenue une interface. Une zone tampon, un sas entre les tumultes sahéliens et la stabilité méditerranéenne. La Russie, mais aussi d’autres puissances comme la Turquie ou la Chine, y testent leurs marges de manœuvre. Moscou, particulièrement, semble vouloir s’ancrer dans cet espace de transition. Non pas par invasion ou base militaire, mais par une logique d’influence, de perturbation, de présence insinuée.
L’Algérie en état d’alerte : entre alliance historique et nouvelles inquiétudes
L’Algérie entretient depuis l’époque soviétique une relation privilégiée avec la Russie. Coopération militaire, convergence politique, méfiance partagée envers l’Occident. Mais l’extension de la présence russe au Sahel et en Libye, y compris par des moyens non étatiques, commence à inquiéter Alger. Car si la Russie est un partenaire, elle est aussi devenue un facteur de désordre à ses portes.
L’affaire du drone malien abattu par l’armée algérienne en mars 2025 a révélé ces tensions. Derrière le drone, il y avait des instructeurs russes. Et derrière les flux migratoires qui franchissent clandestinement le désert nigérien, les renseignements algériens soupçonnent l’action de groupes armés proches de Wagner, facilitant les départs pour alimenter un levier politique contre l’Europe.
La visite du ministre algérien à Tunis, peu avant la libération des ressortissants russes, pourrait alors s’interpréter comme une tentative de contenir l’influence moscovite, ou au moins de la coordonner.
Les États-Unis, la Turquie, la Chine : les autres joueurs de la partie
Si la Russie avance ses pions, elle n’est pas seule à la table. Les États-Unis, bien que partiellement désengagés, continuent de surveiller l’Afrique du Nord. Leur crainte est double : que Moscou s’installe durablement dans le sud méditerranéen, et que des régimes en crise, comme celui de Tunis, tombent dans une dépendance politique ou sécuritaire aux puissances non démocratiques.
La Turquie, quant à elle, soutient le gouvernement libyen rival de celui de Haftar. Elle contrôle déjà, via ses bases militaires en Tripolitaine, des segments de la côte libyenne. Elle regarde aussi du côté de la Tunisie, comme un partenaire islamo-conservateur potentiel, tout en maintenant des liens complexes avec Alger.
La Chine joue une autre partition : celle des infrastructures, des ports, des dettes. Elle n’est pas directement impliquée dans les manœuvres militaires, mais elle tisse une présence économique et diplomatique à long terme. Les câbles sous-marins, les terminaux gaziers et les corridors ferroviaires en projet font partie d’une stratégie plus large, inscrite dans l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie.
Enjeux énergétiques : sous la géopolitique, les pipelines
Au cœur de cette guerre d’influence se trouvent les ressources. Deux projets énergétiques africains retiennent particulièrement l’attention : le pipeline transsaharien Nigeria-Algérie (NIGAL) et le gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP). Ces deux corridors concurrents visent à connecter les réserves de gaz du golfe de Guinée aux marchés européens, via le Maghreb. L’un passe par l’Algérie, l’autre par le Maroc, et chacun représente un enjeu colossal pour l’avenir énergétique du continent.
La Russie, en tant que fournisseur majeur de gaz, observe ces développements avec une attention stratégique. Si l’Afrique subsaharienne devient un exportateur massif vers l’Europe, cela fragilise l’influence énergétique russe. En conséquence, Moscou pourrait chercher à peser sur ces projets, directement ou par alliés interposés.
Et c’est là que la Tunisie redevient clé. Si la Russie réussit à s’ancrer dans le sud tunisien ou à contrôler, même indirectement, certaines routes migratoires ou logistiques, elle dispose d’un moyen de pression supplémentaire, non seulement sur l’Europe, mais sur les compétiteurs régionaux.
Et demain ? Scénarios d’une recomposition maghrébine
À court terme, la Tunisie pourrait se voir proposer plus de "coopération" sécuritaire par les Russes, les Turcs ou les Chinois, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou l'immigration irrégulière. À moyen terme, une polarisation du Maghreb pourrait voir le jour : un axe Algérie-Tunisie influencé par Moscou et Pékin, face à un axe Maroc-Europe-Amérique du Nord.
Mais rien n’est figé. L’instabilité structurelle de la Libye, la fragilité politique tunisienne, les hésitations stratégiques algériennes laissent place à tous les renversements d’alliances.
Une chose est sûre : l’époque où la Méditerranée sud était une arrière-cour de l’Europe est révolue. Désormais, c’est un échiquier global, où se croisent diplomatie de l’énergie, stratégies de puissance et tactiques de subversion.
Et parfois, tout commence par une arrestation, suivie d'une libération, presque passée inaperçue, à Djerba.
dernière vidéo
news via inbox
PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.